

- CAPFIDA
- Actualité
- 02 octobre 2009 - Lancement du séminaire de coopération Sud- Sud entre le FIDA et la Chine.
- 05 octobre 2009 - L´équipe de Madagascar sur le terrain en Chine.
- 13 mars 2009 - Note sur le Suivi-evaluation COSOP 2008
- 15 Décembre 2008 - De nouveaux articles sur le PHBM
- 15 Décembre 2008 - Les cartes Google Earth sont en ligne !
- 20/10/09 - De nouveaux articles à lire sur CapFida.
- 6 janvier 2009 - Marcelline, Sabine et Marie : trois femmes nous présentent leurs filières
- AROPA HAUTE MATSIATRA : éléments sur l’adoption du SRI par les paysans
- Atelier 2006 : Pour une gestion des projets orientée vers l’impact
- De nouvelles vidéos et un nouveau lien pour illustrer et compléter les études de cas.
- Des photos sur les projets de Madagascar sont disponibles sur le site du FIDA.
- Examen réussi pour l’AROPA
- Google Earth et Google Map sur Capfida
- Interview de Thierry Benoît, Chargé de Programme du FIDA pour Madagascar
- La formation de femmes leaders rurales
- Les outils GRD dans les programmes-pays et projets
- Note SE COSOP juillet 2009
- Nouvelles de la semaine du 21/4/2008
- Nouvelles du 12 Novembre
- Nouvelles du 20 Septembre
- Nouvelles du 21 Septembre
- PROSPERER HAUTE MATSIATRA : Le progrès des illettrés
- Video PROSPERER
- Opérations
- Article de presse
- 13 Aout 2008 - Région Analanjirofo : Ar 1 million de recettes pour une campagne rizicole
- 13 Aout 2008 - Une micro-assurance pour réduire les risques
- 13 Aout 2008 - Zoom sur la finance rurale
- 16 Aout 2008 - L’État veut assurer les prêts paysans
- 17 Septembre 2008 - Le FIDA accorde 19 millions de dollars à Madagascar
- 6 Octobre 2008 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE de l’AMBASSADE DE MADAGASCAR EN ITALIE
- L’embouche bovine dans le Mandrare
- La filiere pomme de terre : une filiere porteuse dans la region de L’itasy…
- La production et la dynamique du secteur vivrier marchand
- Les coupons de presse
- LES ENJEUX DE LA CRISE ALIMENTAIRE MONDIALE ET L’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MENABE ET DU MELAKY PAR LE PROJET AD2M
- Les filières porteuses de la Région d’Itasy
- Madagascar nouvelle : le FIDA accorde 64.2 millions de dollars pour la période 2007-2012
- Prévention des conflits fonciers
- Ressources / Information

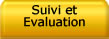


PADANE
Un système innovant de culture de la vanille
mardi 16 décembre 2008
Madagascar, premier exportateur de vanille au monde, assure la moitié de la production mondiale, mais le pays reste l’un des plus pauvres de la planète. La production est essentiellement concentrée dans la région fertile de la SAVA, au nord est de l’île, où environ 70 pour cent de la population dépendent de cette épice lucrative. Mais bien que cette région soit relativement riche par rapport au reste de l’île, il existe malgré tout des disparités importantes entre les petits planteurs et les grandes exploitations qui récoltent la vanille et la préparent pour la commercialiser sur le marché international.
Le projet PADANE financé par le FIDA, qui vient de s’achever, a été mis en place à la toute fin des années 90 ; il visait précisément à remédier à ces disparités et favoriser une répartition plus équitable des avantages économiques dans cette région et à aider les petits paysans à acquérir de nouvelles compétences qui leur permettraient d’augmenter les recettes tirées de la production de vanille et de mieux gérer des revenus en dents de scie.
Dans le cadre de ce projet, une approche plus globale a été adoptée afin de faire le lien entre les différents aspects de la production et du marché ; il s’agissait de développer la production commerciale tout en encourageant l’agriculture de subsistance (traditionnellement la riziculture) et de mettre en place un réseau de caisses de crédit mutuel afin de donner aux paysans pauvres accès aux services financiers, alors qu’ils étaient jusqu’ici exclus du système bancaire et condamnés à souscrire des prêts à des taux d’intérêt élevés.
Ces paysans ont été encouragés à se regrouper au sein d’associations de planteurs de vanille afin d’être en meilleure position pour négocier les prix de vente de leur production. Ils ont appris à préparer la vanille (voir l’encadré ci-dessous) et à la stocker afin d’attendre le moment stratégique où le prix de vente est au plus haut. Dans le cadre de ce projet, plus de 400 associations locales ont été créées sous une forme ou sous une autre ; elles regroupent environ 10 000 membres, et ce chiffre est appelé à augmenter encore.
"Jusqu’à présent, les petits paysans vendaient leur vanille verte juste après la récolte. Lorsqu’elle est fraîche, la vanille ne se conserve pas, ce qui les contraignait à la céder immédiatement à bas prix, car les acheteurs venaient la récupérer tout de suite après la récolte" explique M. Fabien Randriambololona, le responsable du projet. Parallèlement, les paysans ont pu avoir accès aux services financiers grâce à la mise en place d’un réseau de caisses de crédit mutuel. Selon M. Benoit Thierry, le chargé de programme de pays du FIDA pour Madagascar, "il s’agit sans doute du volet le plus probant du projet ; l’objectif consistait à faire le lien entre la production et la vente, et un dispositif d’épargne et de crédit." Auparavant, les petits producteurs ruraux ne disposaient d’aucune solution d’épargne : ils dépensaient les sommes subitement gagnées pour acheter des biens de consommation, chaîne stéréo ou bicyclette par exemple, et se retrouvaient dans une situation extrêmement difficile pour le reste de l’année, puisque la période de commercialisation de la vanille ne s’étend que de juin à octobre, et qu’ils négligeaient l’agriculture de subsistance.
Au total, les objectifs du projet ont été dépassés puisque le réseau de caisses de crédit mutuel comprend 18 agences (contre 14 initialement prévues) desservant 43 communes ; c’est une organisation canadienne spécialiste de la microfinance, Développement international Desjardins (DID), qui se charge de la mise en œuvre sur le terrain. Dans le cadre de ce projet, sur un total d’environ 16 millions de USD, une enveloppe de 1,2 million de USD a été exclusivement consacrée au programme relatif aux mutuelles de crédit, le solde se répartissant entre l’amélioration de la production agricole (irrigation rizicole essentiellement), les infrastructures et l’organisation locale.
La revalorisation de la production de riz, qui constitue la base de l’alimentation à Madagascar, était un volet important du projet, puisque près de 40% du budget total lui étaient consacrés. Des résultats remarquables ont été obtenus dans ce secteur, en particulier grâce à un programme d’irrigation qui a permis de remettre en culture environ 4 600 hectares de petites exploitations pour produire du riz, et grâce à l’introduction de techniques de culture intensive et de variétés de riz plus productives. "La proportion des terres affectées à l’agriculture de subsistance est passée de 5 à 30 pour cent. C’est un succès incontestable à mettre au crédit de ce projet," indique M. Paulin, ancien responsable du projet et actuel Gouverneur pour la région.
Toutefois, en dépit des bons résultats obtenus, le projet a présenté un certain nombre d’inconvénients, en particulier parce qu’il a coïncidé avec une période d’extrême instabilité des prix de la vanille, lesquels se sont envolés pour culminer entre 450 et 500 USD le kilo en 2003 avant de s’effondrer à 25 à 70 USD le kilo (soit leur niveau au tout début du projet, en 1998-1999). La flambée des prix s’explique en partie par le cyclone dévastateur de 2000, qui a détruit une partie des plants, entraînant une pénurie de vanille. De ce fait, il était moins intéressant pour les paysans de se consacrer à la riziculture tant que les prix s’envolaient, tandis qu’après leur effondrement, ils ont éprouvé des difficultés à rembourser les emprunts contractés auprès du réseau de caisses de crédit mutuel (OTIV), surtout en raison d’une épargne insuffisante. En effet, les dépôts se chiffraient à environ 10 à 15 millions de USD, tandis que le montant total des prêts accordés depuis le démarrage du projet s’élevait à environ 32 millions de USD. D’autre part, les paysans n’ont consacré que la moitié du produit des prêts aux investissements, et ils ont dépensé le reste pour améliorer leur qualité de vie, ce qui met d’autant plus en évidence la nécessité de leur apprendre à mieux gérer leurs revenus et à utiliser les dispositifs mis en place pour financer des investissements à long terme.
Maintenant que le projet est achevé, la situation reste difficile car les prix de la vanille sont toujours au plus bas ; pour ne rien arranger, d’autres pays tropicaux se sont mis à cultiver la vanille après la flambée des cours de 2003, ce qui se traduit par une augmentation de la production mondiale interdisant toute remontée des prix.
Malgré tout, grâce au projet, la proportion des revenus que les petits paysans tirent de la vanille a progressé et la production rizicole, qui leur permet d’être autosuffisants, a été relancée, ce qui s’est traduit par une diminution du nombre de familles considérées comme pauvres. Toutefois, il faudra désormais que le projet trouve des prolongements au niveau local : les associations de paysans doivent continuer à fonctionner et regrouper une part plus importante de la population, il faut poursuivre la diversification de la production afin d’atténuer la dépendance à l’égard de la vanille, dont le prix est instable, et le réseau de caisses de crédit mutuel doit attirer plus de membres et développer non seulement l’activité de prêt mais aussi le volet épargne.
Par ailleurs, la mise en place d’une certification internationale de commerce équitable pour la vanille contribuera elle aussi à améliorer les conditions de vie des petits planteurs de Madagascar : comme pour les autres produits, cette certification vise à assurer aux petits exploitants de meilleurs revenus.
 LA CULTURE DE LA VANILLE. Dès sa découverte par les colons européens, la vanille est devenue une épice extrêmement convoitée en raison de sa saveur aussi particulière que raffinée et des différentes qualités qu’on lui prêtait, depuis ses propriétés curatives jusqu’à ses vertus aphrodisiaques. Originaire du Mexique, où les Aztèques l’utilisaient pour parfumer leurs aliments, la fleur de vanilla planifolia – la seule orchidée qui donne des fruits – a été introduite au cours du 19ème siècle dans les colonies françaises de la Réunion et de Madagascar, dans l’Océan indien, mais malheureusement pas l’abeille mexicaine qui assurait la pollinisation. Peu après, un esclave réunionnais du nom d’Albus a inventé une méthode de pollinisation manuelle encore utilisée aujourd’hui, ce qui a permis l’essor de la production de vanille dans cette région humide.
LA CULTURE DE LA VANILLE. Dès sa découverte par les colons européens, la vanille est devenue une épice extrêmement convoitée en raison de sa saveur aussi particulière que raffinée et des différentes qualités qu’on lui prêtait, depuis ses propriétés curatives jusqu’à ses vertus aphrodisiaques. Originaire du Mexique, où les Aztèques l’utilisaient pour parfumer leurs aliments, la fleur de vanilla planifolia – la seule orchidée qui donne des fruits – a été introduite au cours du 19ème siècle dans les colonies françaises de la Réunion et de Madagascar, dans l’Océan indien, mais malheureusement pas l’abeille mexicaine qui assurait la pollinisation. Peu après, un esclave réunionnais du nom d’Albus a inventé une méthode de pollinisation manuelle encore utilisée aujourd’hui, ce qui a permis l’essor de la production de vanille dans cette région humide.
La pollinisation manuelle fait de la vanille l’une des cultures les plus exigeantes en main-d’œuvre au monde, puisqu’il s’écoule jusqu’à 5 ans entre la plantation du vanillier et la production d’une essence de grande qualité. La vanille a dès lors une grande valeur par rapport aux autres épices. Étant donné que la fleur du vanillier ne dure qu’un jour à peu près, les planteurs doivent inspecter leur vanilleraie tous les jours pour guetter l’éclosion des fleurs, afin de ne pas laisser passer la période de pollinisation, ce qui demande beaucoup de main-d’œuvre. Traditionnellement, toute la famille participe à la production : pollinisation manuelle de la fleur, puis récolte, traitement et séchage des gousses. Le traitement consiste à faire bouillir les gousses avant de les faire sécher lentement pendant trois à quatre mois, en alternant exposition au soleil et stockage dans du tissu, jusqu’à qu’elles s’assouplissent et prennent une teinte marron foncé. La vanilline, qui donne à l’épice sa saveur caractéristique, peut alors être extraite de la gousse.
La vanille de synthèse est un produit de substitution moins onéreux que la vanille naturelle ; elle est donc surtout utilisée lorsque les prix sont élevés. Aux États-Unis, les fabricants utilisent volontiers la vanille de synthèse, tandis que les consommateurs européens préfèrent encore la vanille naturelle, qui représente au moins 50 pour cent de la consommation. Dans l’ensemble, on a aujourd’hui tendance à promouvoir la vanille naturelle.
Dominique Magada - Juillet 2006
| Conception : |
||
| Contact : contact@capfida.mg | Copyright CAPFIDA 2011 |







