

- CAPFIDA
- Actualité
- 02 octobre 2009 - Lancement du séminaire de coopération Sud- Sud entre le FIDA et la Chine.
- 05 octobre 2009 - L´équipe de Madagascar sur le terrain en Chine.
- 13 mars 2009 - Note sur le Suivi-evaluation COSOP 2008
- 15 Décembre 2008 - De nouveaux articles sur le PHBM
- 15 Décembre 2008 - Les cartes Google Earth sont en ligne !
- 20/10/09 - De nouveaux articles à lire sur CapFida.
- 6 janvier 2009 - Marcelline, Sabine et Marie : trois femmes nous présentent leurs filières
- AROPA HAUTE MATSIATRA : éléments sur l’adoption du SRI par les paysans
- Atelier 2006 : Pour une gestion des projets orientée vers l’impact
- De nouvelles vidéos et un nouveau lien pour illustrer et compléter les études de cas.
- Des photos sur les projets de Madagascar sont disponibles sur le site du FIDA.
- Examen réussi pour l’AROPA
- Google Earth et Google Map sur Capfida
- Interview de Thierry Benoît, Chargé de Programme du FIDA pour Madagascar
- La formation de femmes leaders rurales
- Les outils GRD dans les programmes-pays et projets
- Note SE COSOP juillet 2009
- Nouvelles de la semaine du 21/4/2008
- Nouvelles du 12 Novembre
- Nouvelles du 20 Septembre
- Nouvelles du 21 Septembre
- PROSPERER HAUTE MATSIATRA : Le progrès des illettrés
- Video PROSPERER
- Opérations
- Article de presse
- 13 Aout 2008 - Région Analanjirofo : Ar 1 million de recettes pour une campagne rizicole
- 13 Aout 2008 - Une micro-assurance pour réduire les risques
- 13 Aout 2008 - Zoom sur la finance rurale
- 16 Aout 2008 - L’État veut assurer les prêts paysans
- 17 Septembre 2008 - Le FIDA accorde 19 millions de dollars à Madagascar
- 6 Octobre 2008 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE de l’AMBASSADE DE MADAGASCAR EN ITALIE
- L’embouche bovine dans le Mandrare
- La filiere pomme de terre : une filiere porteuse dans la region de L’itasy…
- La production et la dynamique du secteur vivrier marchand
- Les coupons de presse
- LES ENJEUX DE LA CRISE ALIMENTAIRE MONDIALE ET L’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MENABE ET DU MELAKY PAR LE PROJET AD2M
- Les filières porteuses de la Région d’Itasy
- Madagascar nouvelle : le FIDA accorde 64.2 millions de dollars pour la période 2007-2012
- Prévention des conflits fonciers
- Ressources / Information

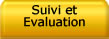


PHBM
Mécanisation agricole : fer de lance d’une meilleure production
lundi 15 décembre 2008
Les riziculteurs de la région de Mandrare ont pu déjouer les méfaits périodiques de la sécheresse grâce à l’adoption des techniques améliorées en agriculture et surtout un meilleur niveau de mécanisation. L’agriculture est devenue une source de revenu considérable.
« On est toujours sûr de trouver du riz à Tsivory, même pendant la période de soudure, contrairement aux autres régions du Sud où c’était la crise habituelle », affirme Janvier Embola, petit collecteur qui fait la navette entre Tsivory et Taolagnaro. Le Haut Bassin du Mandrare, avec ses 25000 tonnes de paddy produits par an, est redevenu depuis la présence du PHBM le grenier agricole de deux régions du Sud de Madagascar : Anosy et Androy.
Les rizières irriguées sont passées de 1100ha à 5000ha en 12 ans. Par ailleurs, 107 associations de producteurs ont été dotées de matériels agricoles durant la deuxième phase du projet. « L’introduction de ces matériels agricoles fait partie de nos grandes participations dans la région », révèle Manoa Andriantsilavo, le Chef de la Cellule Agriculture du PHBM, car il fallait engager des matériels plus perfectionnés pour exploiter les surfaces disponibles ». Plus tard, les producteurs eux-mêmes ont commencé à acquérir ce type de matériels.
En outre, l’initiation au Système de Rizicole Améliorée (SRA) est un autre pas initié par le PHBM. Il a été adopté sur plus de la moitié des surfaces cultivées. Résultat dans toute la zone d’intervention : le rendement moyen est passé à 4,3t/ha pour les cultures qui suivent les nouvelles techniques contre 2t/ha pour les cultures à système traditionnel. "Ces résultats témoignent de l’efficacité de la méthodologie du développement intégré initié par le PHBM." affirme Embola.
Des conditions favorables
Des emprunts rendus possibles par la Mutuelle du Mandrare : une utilisation à plus grande échelle des techniques rizicoles ; la cohabitation du riz avec d’autres types de cultures,… telles sont quelques-unes des conditions qui contribuent à l’amélioration généralisée de la production du Mandrare. « Chose extraordinaire, tout cela a été fait grâce à l’agriculture, dans une région où on a vécu des saisons sèches et une famine périodiques » fait remarquer Andriantsilavo.
Mais fait important en terme de changement depuis l’arrivée en 2003 d’un atelier de fabrication de petits matériels agricoles à Tsivory. Près de 5600 petits matériels, de la charrue à l’arrosoir en passant par la sarcleuse et la pompe à pédale, sont confectionnés à moindres coûts et employés dans le bassin du Mandrare. « Nous sommes là car la demande en petites mécaniques est constante » dévoile Roger, le chef de l’atelier. Les six ferronniers produisent en effet plus de 4 machines par jour et la batteuse, dont le prototype est arrivé en décembre 2006, commence à avoir beaucoup de succès. Mais la réparation n’est pas en reste, preuve que les producteurs bichonnent leurs nouveaux matériels.
A moyen terme, une meilleure production et de meilleures conditions de commercialisation, notamment grâce aux routes d’intérêt régional, ont enrichi les producteurs. « De plus en plus de gens portent des vêtements plus variés et équipent leur maison », remarquent Ndriana et Manantena, des vendeurs itinérants qui fréquentent tous les marchés communaux du Mandrare.
Toutes les conditions sont dès lors réunies pour prédire à la région un avenir meilleur. Ndohany, le lauréat du concours agricole de 2005-2006 constate que « même en 2006 où on il y a eu peu de pluie, le rendement a été maintenu grâce aux infrastructures d’irrigation bien entretenues et aux techniques améliorées adoptées à plus grande échelle ».
Henintsoa Randriamampianina
| Conception : |
||
| Contact : contact@capfida.mg | Copyright CAPFIDA 2011 |







