|
Elevage bovin

1. L’élevage des zébus,
très adapté aux difficiles conditions de la zone,
est d'abord une marque de prestige ainsi que la principale forme
d’épargne et d’investissement, même si
les vols de bœufs sont toujours très répandus.
La conduite de l’élevage est pour la majorité
sédentaire, par peur des vols. L’entretien des parcours
est assuré de manière traditionnelle par les feux
de brousse qui, trop fréquents, les prive d’un bon
couvert et d'espèces apétables, mais susceptibles
pour certaine de se lignifier en fin de saison.. Les pâturages
de la zone du Projet sont surpâturés en des endroits
et sous-pâturés en d’autres et les feux méritent
d’être rationalisés pour maintenir en bon état
les pâturages. Les zébus sont sujets à différentes
maladies et parasites qui entravent la productivité de
l’élevage bovin. L es
principales maladies rencontrées sont le charbon symptomatique
et bactéridien, la tuberculose, la rage. Les principaux
parasites internes et externes sont - en première position
les tiques qui provoquent la maladie hémotozoaire, la streptotricose,
la maladie modulaire cutanée, - la fasciolose et –
les Helminthes qui attaquent essentiellement les veaux. es
principales maladies rencontrées sont le charbon symptomatique
et bactéridien, la tuberculose, la rage. Les principaux
parasites internes et externes sont - en première position
les tiques qui provoquent la maladie hémotozoaire, la streptotricose,
la maladie modulaire cutanée, - la fasciolose et –
les Helminthes qui attaquent essentiellement les veaux.
2. Le système d’élevage
bovin est semi-extensif. A cause du vol des bovidés, la
conduite de l’élevage bovin a changé, les
éleveurs tendent à pratiquer aussi en saison sèche
le gardiennage le jour et le parcage du troupeau près de
l’habitation la nuit. Cette pratique a comme inconvénient
la diminution du temps de pâture des animaux. Pourtant elle
présente de nombreux avantages pour l’amélioration
de la production d’élevage bovin, car les éleveurs
peuvent apporter plus de soins à leurs animaux et produire
du fumier. Le taux de couverture en vaccination est inférieur
de 40% à l’effectif total des bovins en dehors des
4 communes qui constituaient la zone touchée par la première
phase. En revanche, il atteint presque 100% pour les troupeaux
des membres des associations d'éleveurs de la phase I du
PHBM et plus de 60 % pour les non-membres dans ces 4 communes.
3. Les produits de l'élevage de bovins
sont la viande, le lait et les poudrettes de parc. La consommation
de viande de zébus est très faible et se pratique
surtout lors des cérémonies traditionnelles. Moins
d'un bœuf est abattu chaque jour à Tsivory. Le lait
est le plus souvent destiné à la consommation familiale,
mais certains paysans en vendent au marché sous forme de
lait pur ou transformé en lait caillé. Les zébus
tiennent une place très importante dans l'agriculture.
En effet, ils constituent la force de travail pour la préparation
des sols de cultures (piétinement ou labour à la
charrue) et le transport des produits agricoles. La surface cultivée
dépend de la force de travail des zébus. Les poudrettes
de parc ne sont pas encore utilisées pour fertiliser les
sols à l'exception de quelques paysans qui emploient des
petites quantités sur les parcelles de cultures.
Elevage bovin
4. C'est le point le plus délicat du
volet élevage du PHBM-II, qui avait un objectif clair d'amélioration
de la production bovine, sans résultat significatif à
ce jour. Nous pouvons néanmoins considérer que l'amélioration
remarquable de la couverture sanitaire constitue un préalable.
La commercialisation des bovins est freinée par un facteur
culturel fort, favorisant la thésaurisation à travers
le troupeau bovin, signe de prestige, et considérant la
vente de bétail comme honteuse. Cette perception rest e
toujours très marquée chez les éleveurs.
Lorsqu'il y a vente, elle n'est pas rationnellement organisée,
en choisissant par exemple les bêtes du meilleur ratio âge-poids.
Les efforts d'amélioration sanitaire, comme les revenus
des MP productifs, semblent maintenant conduire à une croissance
improductive du troupeau. Celle-ci menace une ressource en pâturages
mal exploitée, puisque les pâturages éloignés
ne sont pas/peu fréquentés par peur des vols de
bétail - très répandus dans la zone - et
que les pâturages de proximité, permettant de ramener
le troupeau au village chaque soir, sont, en conséquence,
surexploités. Ce n'est pas l'impact recherché par
le PHBM-II. e
toujours très marquée chez les éleveurs.
Lorsqu'il y a vente, elle n'est pas rationnellement organisée,
en choisissant par exemple les bêtes du meilleur ratio âge-poids.
Les efforts d'amélioration sanitaire, comme les revenus
des MP productifs, semblent maintenant conduire à une croissance
improductive du troupeau. Celle-ci menace une ressource en pâturages
mal exploitée, puisque les pâturages éloignés
ne sont pas/peu fréquentés par peur des vols de
bétail - très répandus dans la zone - et
que les pâturages de proximité, permettant de ramener
le troupeau au village chaque soir, sont, en conséquence,
surexploités. Ce n'est pas l'impact recherché par
le PHBM-II.
5. Il existe cependant des signaux positifs
qui permettent d'envisager l'amélioration des revenus des
éleveurs par la commercialisation :
• Les ventes de bétail enregistrées (qui
représenteraient 60 à 70 % des ventes réelles)
croissent régulièrement et s'accélèrent
dans les dernières années. Il existe déjà
des circuits d'exportation du bétail de Tsivory vers d'autres
estimations (le Nord, l'Est, la zone de Tolagnaro)
Tableau 1 : Ventes d'animaux contrôlées
à Tsivory
| Années |
Ventes bovins |
Ventes ovins |
Vente caprins |
| 1996 |
2 648 |
933 |
2 134 |
| 1997 |
933 |
762 |
2 367 |
| 1998 |
2 134 |
1 340 |
2 089 |
| 1999 |
5 569 |
2 310 |
4 254 |
| 2000 |
6 340 |
1 993 |
4 900 |
| 2001 |
6 843 |
1 293 |
5 029 |
| 2002 |
7 950 |
2 914 |
5 450 |
| 2003 |
8 123 |
3 214 |
6 622 |
| 2004 |
11 003 |
2 746 |
6 789 |
Source/ cellule Elevage,
PHBM
-
Les éleveurs admettent de vendre des têtes de
bétail pour se procurer différents articles
: vélo, matériel agricole, produits et services
vétérinaires… Or, avec le désenclavement,
le crédit, l'intensification des productions végétales,
les besoins augmentent, et donc les occasions de déstocker
des bêtes.
-
L'apport par le PHBM-II d'informations, de formation et
d'alphabétisation contribue à "ouvrir les
esprits" selon les dires des éleveurs eux-mêmes.
Cette évolution est favorable à l'évolution des pratiques.
à l'évolution des pratiques.
-
Le pôle de développement minier de Tolagnaro
va, à l'évidence, créer des besoins importants
en consommation. On ne peut encore prédire si la reprise
des exportations de bétail sur pieds peut profiter
à la région.
6. Le moment est donc venu d'engager une action
dans ce sens et c'est bien la responsabilité du PHBM-II.
Les discussions menées à Tsivory montrent l'intérêt
de mener parallèlement deux actions :
i) Des tests d'élevage à vocation
commerciale, incluant :
-
L'identification d'éleveurs motivés (même
s'ils sont individuels, dès qu'ils appartiennent
au groupe cible) et l'appui à des tests de production
bovine.
-
La mise au point d'un itinéraire technique provisoire,
maximisant le recours aux composants alimentaires locaux
et bénéficiant des progrès faits en
matière de prévention sanitaire.
-
L'amélioration progressive de l'itinéraire
technique selon les possibilités.
-
Un suivi sociologique, zootechnique et économique
de ces expériences.
ii) Une étude de base de la filière
bovine régionale, appuyée sur une étude
documentaire poussée et une analyse des expériences
à Madagascar. Ici aussi, il convient de rechercher la
participation effective de la Région, avec un cofinancement,
par exemple du projet ACORDS, compte tenu de l'enjeu de cette
filière à la fois pour la consommation du pôle
de Tolagnaro et par de possibles exportations par son nouveau
port, dès 2008 . Cette étude inclurait les éléments
suivants :
-
Etude sociologique des pratiques de l'élevage et
des ventes.
-
Etude de la demande : marchés possibles sous leurs
différentes formes, concurrence et conditions de
compétitivité.
-
Etude de l'offre : facteurs de déstockage, organisation
de l'offre et du transport.
-
Analyse des mesures d'accompagnement : promotion du déstockage,
mesures incitatives, sécurité des troupeaux
et des transports, couverture sanitaire, organisation des
marchés
-
Recommandations zootechniques, d'amélioration des
pâturages, d'intégration aux productions végétales.
-
Analyse économique et financière.
7. Compte tenu de la complexité du sujet,
il est souhaitable que le PHBM-II mandate en gré à
gré un expert incontestable pour réaliser un prédiagnostic
et élaborer les termes de référence de l'étude
ou des différentes études à mener. Une consultation
du FOFIFA, du MAEP et de la FAO, ainsi que des bailleurs investis
dans cette filière, est jugée souhaitable afin d'identifier
l'expertise appropriée.
8. Le résultat attendu en fin de projet
en matière d'élevage bovin peut être reformulé
comme suit :
i) les actions à mener pour l'amélioration
de l'élevage bovin et le renforcement de sa commercialisation
sont connues et expérimentées
ii) les modalités de pilotage et de
finalisation de l'exécution de ces actions au-delà
de l'achèvement du PHBM-II sont définies, connues
et acceptées par les parties prenantes.
Amélioration des pâturages
9. Cette activité est menée dans
deux directions :
i) Amélioration de pâturages
par une meilleure gestion des feux (voir §.225 ci-après),
justifiée par l'appauvrissement et la dégradation
des pâturages naturels sous l'effet des feux non contrôlés.
ii) Introduction et culture de plantes fourragères
pour améliorer les parcours villageois et fournir des
compléments fourragers aux élevages de petits
ruminants.
10. Cette activité est encore peu développée.
Elle se heurte au manque d'intérêt des éleveurs
pour la gestion d'une ressource perçue comme abondante
et au manque de semences adaptées. La pratique extensive
de l'élevage est également dissuasive d'efforts
des éleveurs dans ce sens. Enfin, la maîtrise insuffisante
des feux de pâturage, comme de la divagation des troupeaux, peut
réduire à néant les efforts éventuellement
consentis. Enfin, la récolte des fourrages et leur stockage
n'est pas dans les habitudes des éleveurs.
de pâturage, comme de la divagation des troupeaux, peut
réduire à néant les efforts éventuellement
consentis. Enfin, la récolte des fourrages et leur stockage
n'est pas dans les habitudes des éleveurs.
11. Cet objectif se heurte donc à des
difficultés nombreuses mais un premier résultat
remarquable a été obtenu par l'agrément d'un
dina intercommunal sur la gestion des feux. Le PHBM encourage
également la réintroduction du cactus inerme surpâturé
dans la zone mais encore présent plus au sud. A date de
revue, 6 686 plants de cactus inerme ont été plantés
et 13 ha de fourrages ont été réalisés
à base de Bracharia, Brizantha, Chloris gayana.
12. Compte tenu de ce qui précède
en matière de production animale, les orientations possibles
consisteraient à :
i) mettre l'accent sur le suivi de l'application
du dina sur les feux
ii) différer les opérations
d'amélioration des parcours dans l'attente des recommandations
de l'étude de base sur la filière bovine
iii) concentrer les cultures fourragères
sur les MP de production caprine à la fois pour sécuriser
l'alimentation, constituer des réserves en eau (cactus
inerme) et permettre une surveillance rapprochée des
zones cultivées, nécessairement situées
à proximité des chèvreries.
Sécurité des troupeaux
13. La mesure non abordée par le PHBM-II
concerne la sécurité des troupeaux qui peut mettre
en œuvre des actions dans la gestion même des animaux
(marquage, par exemple) mais surtout, et c'est la demande générale,
un renforcement de la présence de la force publique, hors
de la compétence des communes. A travers le projet ACORDS,
l'Union européenne a dérogé au principe d'appui
aux communes en acceptant le financement de postes avancés
de gendarmerie, reconnaissant de fait la sécurité
comme une fonction de développement rural. Le PHBM aura
contribué à l'amélioration générale
de la situation par le désenclavement, facilitant l'accès
aux zones les plus menacées. Il devra également
participer à cet objectif en analysant les questions de
sécurité et les réponses possibles dans l'étude
de la filière bovine.
2.2.2.1. Miniprojets bovins
Les miniprojets bovins concernent l’amélioration
de la conduite des animaux, en particulier ceux destinés
à la vente après avoir convaincu les éleveurs
à déstocker certains de leurs animaux. La méthode
consiste à :
(i) séparer les animaux prévus
à la vente des autres animaux
(ii) leur apporter des compléments
d’aliments à base de sous produits agricoles
(iii) les traiter systématiquement
contre les maladies
(iv) améliorer leur habitat.
Les actions notables entreprises concernant ce type de MP sont
les suivantes :
-
Construction de couloirs de à vaccination, de bacs
et de bains détiqueurs
-
Traitements sanitaires
-
Amélioration de l’alimentation : culture de
pennisetum (5 ha), culture de braccharia (5 ha), culture
de cactus inermes
-
Animations sur le destockage des animaux qui consiste à
pousser les éleveurs à mettre à une
partie de leur produit de vente à la Mutuelle d’épargne
et de crédit de Mandrare.
-
Formation sur la conduite et la gestion de l’embouche
bovine
-
Organisation d’une première vente groupée
d’incitation dans la zone Ouest
-
Mise en place de parc avec abri.
-
Renforcement des capacités de l’encadrement
et des éleveurs
2.2.2.2. Réalisations
a. Grands indicateurs (cumul entre 2001
et 2006)
| Miniprojets caprins |
82 |
| Caprins distribués |
2419 |
| Groupements bénéficiaires |
82 |
| Bénéficiaires |
3073 (1071 H, 832 F, 1170 J) |
| Couloirs de vaccinations |
67 |
| Bacs détiqueurs |
21 |
| Bains détiqueurs |
2 |
| Animaux vaccinés |
78 743 |
| Animaux déparasités (internes et externes) |
42 271 |
| Points de ventes de produits vétérinaires |
8 |
b. Situation actuelle des élevages
caprins
Un état des lieux de la situation des élevages
caprins est résumé ci-dessous :
| Bénéficiaires |
2001 |
2006 |
Écarts |
| Total |
3073 |
2868 |
- 205 |
| Hommes |
1071 |
1002 |
-69 |
| Femmes |
832 |
777 |
- 55 |
| Jeunes |
1170 |
1089 |
- 81 |
Bénéficiaires :
Beaucoup de jeunes et d’adultes ont quitté les groupements
à la recherche de ressources monétaires externes
à l’intérieur et à l’extérieur
de la zone (150 au total). Les emplois dans les chantiers miniers
traditionnels et industriels comme le projet minier de Fort Dauphin
semblent leur lieu de destination préféré.
Les femmes, elles, quittent les groupements pour rejoindre le
domicile conjugal suite à des mariages (55). Ces départs
ne signifient pas un abandon de la spéculation, encore
moins du groupement ; ils relèvent plus d’une stratégie
de diversification des revenus. Quelques cas d’exclusions
sont tout de même signalés à la suite de désaccords
internes.
Caprins: Le nombre total d’animaux
distribués était de 2419 têtes en 2001, il
n’est plus que 2157 en 2007, soit une diminution de 262
têtes. Leur répartition par types, par sexe et par
âge est la suivante :
Composition par type, sexe et âge
|
2001 |
2007 (mars) |
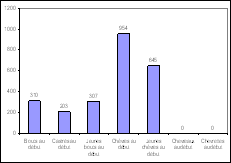 |
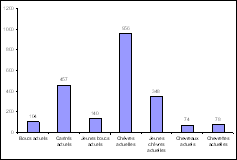 |
| Proportions de mâles
et de femelles |
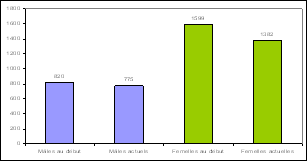
Les mâles et les femelles ont subi une diminution de l’effectif,
mais cette chute est plus accentuée au niveau du nombre
de femelles, ce qui présente une menace de régression
numérique du cheptel. Malgré les naissances le nombre
actuel du cheptel reste inférieur au nombre du cheptel
d’origine. Ces facteurs de régression du nombre d’animaux
sont la vente, la mortalité et les vols des animaux.
Composition des animaux vendus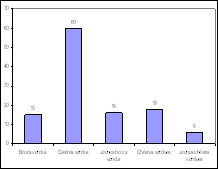
-
115 animaux sont déclarés vendus, soit un taux
d’exploitation en vente du cheptel de l’ordre
de 5 %, très faible compte tenu des performances de
reproduction et de croissance pondérale des caprins
de race locale, et du temps écoulé. Les animaux
vendus sont essentiellement composés de castrés.
Le montant déclaré des ventes est de 2 766 500
Ariary, soit 24 057 Ariary/caprin considéré
comme faible.
Ces sont les groupements qui sont installés avant 2006
qui auraient le plus vendus (20 groupements au total, ceux installés
en 2006 n’ont pas encore atteint le stade de commercialisation).
Ces groupements évoquent plusieurs raisons de vente :
• les difficultés liées aux conséquences
de la sécheresse
• les besoins quotidiens
• les achats de produits vétérinaires
• pour adhérer au réseau FIVOY
Composition des animaux morts
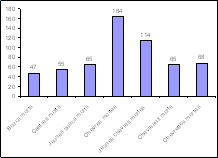 Toutes
les catégories sont atteintes par la mortalité,
mais celle la plus atteinte est celle des chèvres (164)
suivie de celle des jeunes (133). La proportion de femelles est
plus importante que celle des mâles (346 femelles pour 232
mâles), en valeur absolue. Toutes
les catégories sont atteintes par la mortalité,
mais celle la plus atteinte est celle des chèvres (164)
suivie de celle des jeunes (133). La proportion de femelles est
plus importante que celle des mâles (346 femelles pour 232
mâles), en valeur absolue.
Les maladies incriminées sont la gastro-entérite,
les dermatoses, les parasites internes, ... Ces maladies traduisent
l’incapacité des éleveurs à se procurer
des produits vétérinaires du fait du manque d’argent
et/ou de l’indisponibilité des produits vétérinaires
à proximité. La sous alimentation a du également
aggraver la situation
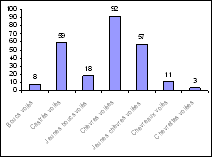 . .
Composition des animaux volés
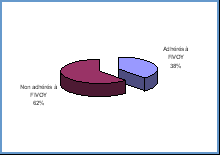
C. Engraissement bovin
Cette activité n’a pas vraiment été
développée. Seuls 18 bovins sont déclarés
engraissés et mis en vente.
d. Renforcement des capacités
-
Recrutement et formation de Responsables
techniques villageois (RTV) issus des groupements  (2
par groupement) suivis de dotation de matériel technique.
La formation est relative aux techniques de conduite des animaux,
de vermifugation, de diagnostic et de traitement des maladies
courantes, de la prophylaxie médicale et sanitaire,
du pesage périodique des animaux( le gain de poids
vif) et de la vente groupée. Ils sont uniquement chargés
des petits ruminants. Au total 128 RTV ont été
recrutés et formés. (2
par groupement) suivis de dotation de matériel technique.
La formation est relative aux techniques de conduite des animaux,
de vermifugation, de diagnostic et de traitement des maladies
courantes, de la prophylaxie médicale et sanitaire,
du pesage périodique des animaux( le gain de poids
vif) et de la vente groupée. Ils sont uniquement chargés
des petits ruminants. Au total 128 RTV ont été
recrutés et formés.
-
Recrutement et formation de vaccinateurs
villageois (VV) chargés d’organiser les
campagnes de vaccination des bovins et de vacciner. Ils sont
également issus des groupements et proposés
par les par les groupements (2 par groupement). Ils sont 124
répartis au niveau des groupements. Leur choix est
validé par le mandataire vétérinaire.
-
Recrutement et formation de vaccinateur
communaux (VC) à raison de 1 par commune (soit
11 au total) chargé de planifier les campagnes de vaccination
au niveau de chaque commune, de superviser les VV, d’assurer
l’interface entre la commune et le Mandataire vétérinaire
seul responsable technique des vaccinations. Les VC sont choisis
parmi les VV après un test de compétence organisé
par le mandataire vétérinaire et une approbation
des groupements.
-
Renforcements des capacités
des groupements par des formations sur la conduite
de l’élevage, la prophylaxie des animaux (médicale
et sanitaire, les cultures fourragères et les réserves
d’alimentation, la commercialisation.
-
Formation des responsables de points
de vente de produits vétérinaires en
matière de comptabilité élémentaire
et de connaissances de base en soins vétérinaires.
Impacts
Elle s’observe surtout chez les bovins, dont la vaccination
est rendue plus facile par la formation de personnel auxiliaire
pour démultiplier les tâches du mandataire vétérinaire
: en organisation et systématisant les campagnes de vaccination.
Certaines maladies comme le charbon symptomatique et bactéridien
sont totalement contrôlées. La proximité des
couloirs de vaccination et des points de vente a facilités
l’organisation et l’efficacité des traitements
contre les maladies.
Sur ce point la mise en place des couloirs de vaccination a joué
un rôle essentiel, autou r
desquels se sont organisés d’abord les éleveurs
pour leur gestion. C’était une « porte d’entrée
» pour le Projet qui a ensuite organisé un programme
de sensibilisation pour des approvisionnement groupés de
produits vétérinaires, de déstockage des
animaux destinés à la vente et l’épargne. r
desquels se sont organisés d’abord les éleveurs
pour leur gestion. C’était une « porte d’entrée
» pour le Projet qui a ensuite organisé un programme
de sensibilisation pour des approvisionnement groupés de
produits vétérinaires, de déstockage des
animaux destinés à la vente et l’épargne.
Le recrutement et le renforcement des capacités des vaccinateurs
villageois et communaux qui peuvent fournir des conseils aux éleveurs,
des soins obligatoires ou de routine sont un atout majeur pour
l’autonomie du système de soins des animaux. Au-delà
de la création de nouveaux acteurs, le Projet a joué
un rôle crucial de médiation pour faciliter le montage
de nouveaux arrangements institutionnels entre, d’une part,
ces nouveaux acteurs et les éleveurs et, d’autre
part, entre les éleveurs regroupés et les autorités
locales. Le Projet les a ensuite légitimés en les
intégrant dans son dispositif d’intervention.
ARTICLE (de Sylvie Le Guével)
|